Le Titanic : 100 ans après l’événement qui a bouleversé le monde
Cent ans après sa disparition dans les eaux glacées de
l'Atlantique Nord, le Titanic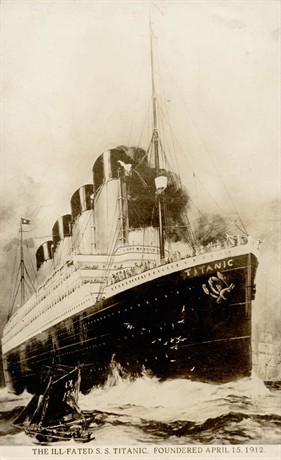 demeure un sujet
d'intérêt répandu partout sur la planète, en particulier pour les
Canadiens, en raison des nombreux liens fascinants qui relient
notre pays au destin du célèbre paquebot.
demeure un sujet
d'intérêt répandu partout sur la planète, en particulier pour les
Canadiens, en raison des nombreux liens fascinants qui relient
notre pays au destin du célèbre paquebot.
Le Titanic était une merveille de son époque et a
immédiatement capté l'imaginaire du public. Bien qu'il n'ait été à
flot que pendant une brève période, il a laissé des marques
indélébiles dans l'histoire. Construit au chantier naval Harland
and Wolff de Belfast, en Irlande (Royaume-Uni), le RMS (Royal Mail
Ship) Titanic était un navire de la White Star Line
appartenant à la classe Olympic. Il devait se joindre à son
navire-frère le RMS Olympic sur la ligne
transatlantique afin de concurrencer le RMS Lusitania
et le RMS Mauretania de la Cunard Line, ainsi qu'un
navire plus petit de la Canadian Pacific Line, le S.S. Empress of Ireland.
Le 10 avril 1912, le Titanic amorce son voyage
inaugural depuis Southampton, en Angleterre, jusqu'à New York.
Après avoir fait halte dans deux ports pour embarquer d'autres
passagers, le Titanic met le cap sur l'Atlantique avec
2 200 personnes à son bord. Pendant sa progression vers
l'océan, les passagers et les membres de l'équipage s'engagent dans
une confortable routine de vie en mer.
Jeune navire-frère du Olympic (1911) et prédécesseur du
Britannic (1914), le Titanic est le deuxième de
trois grands navires construits pour assurer le transport de
passagers sur la ligne de l'Atlantique Nord. Il faut trois ans pour
le construire le Titanic, qui est réputé
« insubmersible ». Cette rumeur vient peut‑être de ses
nombreuses caractéristiques de sécurité, ainsi que de sa taille et
du luxe qu'on trouve à bord, éléments vantés par la White Star
Line, fière propriétaire du navire. L'hébergement des passagers se
traduit par de luxueuses suites de première classe dans les styles
géorgien et Louis XVI, mais également par des installations plus
fonctionnelles pour les émigrants voyageant dans l'entrepont. Le
capitaine Edward J. Smith commande le Titanic et son
imposant équipage de 860 membres, qui comprend officiers,
matelots de 2e classe, quartiers-maîtres, chauffeurs,
soutiers, stewards, personnel de restaurant, commis des postes,
cuisiniers, ingénieurs et coiffeurs, entre autres. En tant que
navire de courrier royal, le paquebot a même son propre bureau de
poste, et la compagnie se targue d'avoir aménagé à bord son propre
système téléphonique, des restaurants, des salles de réception, des
bibliothèques, une piscine et des salons de coiffure! C'est une
véritable ville flottante.
 Bien que la présence
d'icebergs dans la région soit connue, le Titanic
progresse à plus de vingt nœuds à l'approche des côtes de
Terre‑Neuve, en cette nuit claire et calme du 14 avril. À
23 h 40, les vigies aperçoivent un iceberg et, malgré une
manœuvre d'évitement, l'énorme bloc de glace flottant heurte le
Titanic à tribord (droite), et vient érafler puis rompre
la coque sur près de cent mètres. Malgré l'étanchéité des portes,
le volume d'eau dépasse en vingt minutes la capacité de pompage du
navire. Les cloisons étanches ne sont pas suffisamment hautes et, à
mesure que chaque compartiment se remplit, l'eau déborde dans le
compartiment suivant. Le sort du navire en est jeté. Les stewards
conduisent les passagers sur les ponts et, à minuit vingt, les
canots de sauvetage commencent à descendre le long des flancs du
paquebot. Certains refusent de quitter le navire, et d'autres
attendent encore de l'aide. Par conséquent, les premiers canots de
sauvetage prennent le large partiellement vides. Des signaux de
détresse sont envoyés sans relâche par des opérateurs de la station
de radiotélégraphie Marconi Jack Phillips et Harold Bride, de
0 h 15 à 2 h 17, soit jusqu'à trois minutes avant que le
Titanic sombre sous les vagues.
Bien que la présence
d'icebergs dans la région soit connue, le Titanic
progresse à plus de vingt nœuds à l'approche des côtes de
Terre‑Neuve, en cette nuit claire et calme du 14 avril. À
23 h 40, les vigies aperçoivent un iceberg et, malgré une
manœuvre d'évitement, l'énorme bloc de glace flottant heurte le
Titanic à tribord (droite), et vient érafler puis rompre
la coque sur près de cent mètres. Malgré l'étanchéité des portes,
le volume d'eau dépasse en vingt minutes la capacité de pompage du
navire. Les cloisons étanches ne sont pas suffisamment hautes et, à
mesure que chaque compartiment se remplit, l'eau déborde dans le
compartiment suivant. Le sort du navire en est jeté. Les stewards
conduisent les passagers sur les ponts et, à minuit vingt, les
canots de sauvetage commencent à descendre le long des flancs du
paquebot. Certains refusent de quitter le navire, et d'autres
attendent encore de l'aide. Par conséquent, les premiers canots de
sauvetage prennent le large partiellement vides. Des signaux de
détresse sont envoyés sans relâche par des opérateurs de la station
de radiotélégraphie Marconi Jack Phillips et Harold Bride, de
0 h 15 à 2 h 17, soit jusqu'à trois minutes avant que le
Titanic sombre sous les vagues.
Le destin tragique des personnes qui ont péri dans ce naufrage
est bien connu. Les survivants relatent que, tout au long de ce
branle‑bas éprouvant, les musiciens ont continué de jouer pour
calmer les passagers, notamment des ragtimes et l'hymne
« Nearer my God, to thee » (Plus près de toi, mon Dieu),
tandis que le Titanic sombrait. Bon nombre d'employés à
bord périssent, notamment Thomas Andrews, le concepteur du navire,
dont la bravoure et l'attitude exemplaire ne feront pas défaut
pendant tout le déroulement des événements. Le capitaine Smith est
également englouti avec son navire, tandis que
J. Bruce Ismay, l'un des directeurs de la White Star
Line, trouve place à bord d'un canot de sauvetage; il sera plus
tard sévèrement critiqué pour cet acte et pour le nombre
insuffisant de canots de sauvetage. Sous les ponts, les
35 ingénieurs du navire, dirigés par Joseph Bell, demeurent
tous héroïquement à leur poste dans la chambre des pompes, la salle
des dynamos et la chaufferie, continuant au péril de leur vie de
faire fonctionner les pompes et les lumières électriques, et ce,
beaucoup plus longtemps que prévu - jusqu'à seulement quelques
minutes avant l'immersion définitive du navire.
Parmi les nombreux passagers célèbres qui ont perdu la vie cette
nuit‑là se trouvait Charles Melville Hays, président de la Grand
Trunk Railway, qui ramenait des meubles de salle à manger pour son
nouvel hôtel Château Laurier, à Ottawa. Le riche homme
d'affaires d'Halifax George Wright était aussi du voyage. Wright,
qui s'est rendu en Angleterre en 1912 et a acheté son passage de
retour à bord du Titanic, est mort noyé dans le naufrage
du luxueux paquebot. Pendant son séjour en Angleterre, il avait
refait son testament, léguant 226 000 $ à des œuvres de
bienfaisance et sa maison de l'avenue Young, à Halifax, au Conseil
des femmes. La maison George Wright est un monument bien connu à
Halifax et, du point de vue architectural, l'une des plus
importantes résidences de cette époque en Nouvelle‑Écosse.
Le grand nombre de victimes dans ce naufrage est en grande
partie attribuable au fait que, même s'il était conforme à la
réglementation de l'époque, le navire ne transportait que
20 canots de sauvetage, d'une capacité totale de 1 178
personnes. Le nombre disproportionné de victimes masculines est dû
au protocole appliqué par l'équipage selon lequel il faut sauver
« les femmes et les enfants d'abord ». Les survivants du
Titanic ont été secourus par le Carpathia de la
Cunard Line, qui s'est rendu sur les lieux à pleine vitesse après
avoir entendu les appels à l'aide du Titanic à
0 h 25; il est arrivé sur place vers 4 h. Des
navires ont été envoyés d'Halifax, le port d'envergure le plus près
du lieu de l'accident, ayant pour sinistre tâche de repêcher les
victimes; ils sont rentrés au port avec 209 corps.
 Le révérend Canon Kenneth
Hinds, de la All Saints Cathedral, et l'entrepreneur local John
Snow se rendent sur place à bord du S.S. MacKay-Bennett,
l'un des navires ayant participé aux opérations de sauvetage. Parmi
les nombreux corps récupérés figure celui de l'homme d'affaires
John Jacob Astor, passager le plus riche à bord du
Titanic, et le chef de l'orchestre du navire Wallace
Hartley, retrouvé avec son porte‑musique. Une fois amenées à
Halifax, les dépouilles des victimes sont transportées jusqu'au
Mayflower Curling Rink (établi en 1905), lieu utilisé
temporairement comme morgue; il est détruit cinq ans plus tard dans
l'explosion d'Halifax.
Le révérend Canon Kenneth
Hinds, de la All Saints Cathedral, et l'entrepreneur local John
Snow se rendent sur place à bord du S.S. MacKay-Bennett,
l'un des navires ayant participé aux opérations de sauvetage. Parmi
les nombreux corps récupérés figure celui de l'homme d'affaires
John Jacob Astor, passager le plus riche à bord du
Titanic, et le chef de l'orchestre du navire Wallace
Hartley, retrouvé avec son porte‑musique. Une fois amenées à
Halifax, les dépouilles des victimes sont transportées jusqu'au
Mayflower Curling Rink (établi en 1905), lieu utilisé
temporairement comme morgue; il est détruit cinq ans plus tard dans
l'explosion d'Halifax.
Les services religieux ont lieu à la basilique St. Mary, à la Brunswick Street United Church,
à l'église anglicane St. George (église ronde),
à la All Saints Cathedral et à l'église St. Paul. Cinquante‑neuf victimes sont
rendues à leurs familles. Cent cinquante autres sont enterrées
dans trois cimetières d'Halifax, en mai et en juin 1912 :
19 au cimetière catholique Mount Olivet, 10 au cimetière juif Baron
de Hirsch et 121 au cimetière Fairview Lawn. Bien que certaines
victimes aient droit à des pierres tombales élaborées, la plupart
sont inhumées avec de simples blocs de granit payés par la White
Star Line en 1912. L'église St. Paul continue aujourd'hui de
tenir des cérémonies spéciales, notamment des services à la mémoire
des victimes du Titanic.
En 1985, l'emplacement de l'épave du Titanic a
finalement été repéré par une expédition franco‑américaine dirigée
par le chercheur Robert Ballard. En retournant visiter l'épave en
2004, Ballard a noté que beaucoup d'artéfacts avaient été retirés
du navire depuis sa découverte initiale. Sans protection légale,
l'épave risque d'encourir une détérioration naturelle et des
dommages causés par les visiteurs et les opérations de
récupération. Plusieurs pays négocient une entente visant à
protéger les épaves sous‑marines. L'entente désignera le
Titanic en tant que monument commémoratif maritime
international, établira une réglementation pour la visite du site
et fournira un système de documentation des artéfacts retirés de
l'épave afin qu'ils puissent être présentés au public.
L'entente constitue une étape importante dans la protection de ce
navire historique contre d'autres dommages et dans la
reconnaissance du paquebot comme monument  commémoratif.
commémoratif.
Ce terrible événement est reconnu comme l'un des pires désastres
maritimes de l'histoire. L'enquête qui a suivi a mené au réexamen
des procédures de sécurité maritime, qui n'avaient pas suivi le
rythme de croissance rapide de la taille des navires. Il semble
qu'une série d'éléments, dont des défauts de conception, des
erreurs humaines et la malchance, se soient combinés pour produire
une catastrophe qui continuera d'alimenter l'imagerie populaire au
cours des cent prochaines années.